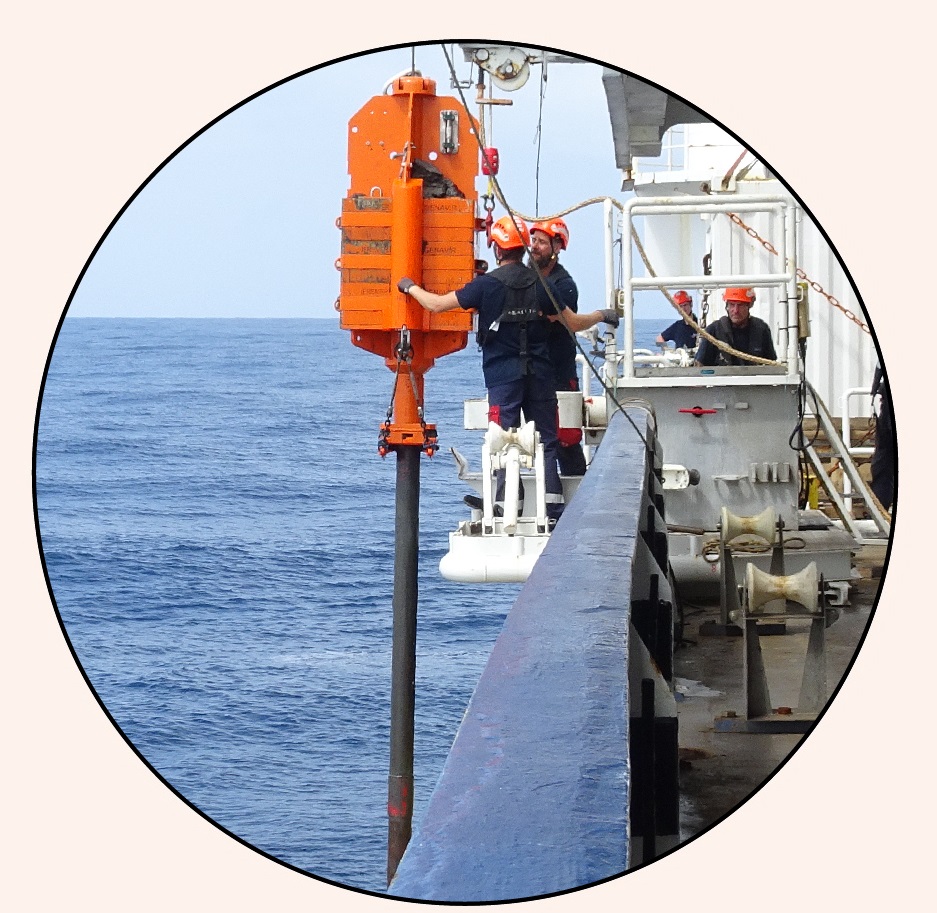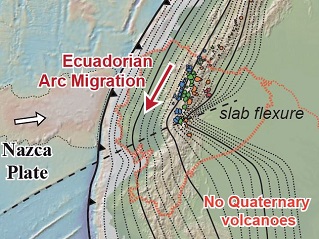Mathilde BABLON
Chargée de Recherche IRD
Laboratoire Géoazur
Équipe Dynamique de la Terre et des Planètes
2ème étage, bureau A 412
Sophia Antipolis, France
Contact : mathilde.bablon@geoazur.unice.fr